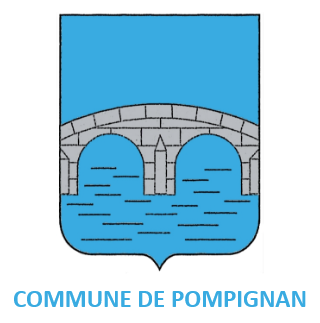Vous êtes ici : Accueil > Culture / Loisirs > Tourisme > Mirabel le Vieux
La visite du site de Mirabel (Pompignan, Gard), le samedi 26 avril 2014, a donné lieu à de multiples échanges ayant permis d’affiner les connaissances générales quant à la mise en place, la chronologie et la fonction possible de cet ensemble fortifié inédit. Ce compte-rendu tend donc davantage à synthétiser les différentes observations, contradictions et points de convergence qui ont pu être soumis à débat lors de cette visite, dans l’attente d’une étude approfondie (fouille, relevé, documentation) de ce site essentiel. Les lectures interprétatives réalisées sur place ont bénéficié des regards croisés de plusieurs participants, eu égard à leurs horizons disciplinaires variés et à leurs approches sensibles, mêlant à la fois les données de terrains aux connaissances plus générales, relatives à l’architecture, à l’urbanisme et à l’histoire à l’échelle régionale, et plus précisément à l’échelle du Languedoc médiéval. Parmi les interrogations majeures suscitées par le site et partagées par tous les participants figure en premier lieu la question de l’époque de construction, d’usage et d’abandon de ce site, qui semble avoir connu une vie active très courte dans le Moyen Âge avant d’être remplacé tardivement par l’actuel château Renaissance posé à son pied.
La montagne Saint-Jean (402 m), qui ferme au sud le bassin d’effondrement de la haute vallée du Vidourle entre Saint-Hippolyte et Sauve, est encadrée de part et d’autre par la chapelle Saint-Jean et par le site castral de Mirabel. Enveloppant l’extrémité de la croupe orientale de la montagne, le site est constitué de trois entités étroitement imbriquées, phasées par les harpes* d’attente entre elles : - barrant l’éperon, le mur bouclier (schildmauer) de 18 m de long (axe nord/sud) pour une épaisseur oscillant entre 1,80 à 1,90 m, de facture soignée (moyen appareil régulier, bossages épars, mortier de chaux), percé d’archères courtes, est le premier élément construit. Les harpes* d’attente sur son revers indiquent qu’il était d’emblée prévu pour recevoir murs latéraux et bâtiments construits plus sommairement. S’y adosse, au point le plus haut, une salle à tour désignant le château proprement dit.
Au-delà se développe une muraille épousant la rupture de pente, percée de deux portes, contre laquelle s’adosse une vingtaine de maisons régulières ouvrant sur une rue centrale s’évasant en placette en contrebas de la citerne contrôlée par le château. L’emploi d’un appareil allongé, l’utilisation d’un mortier maigre (fluage systématique des joints), les nombreuses assises de panneresses, la systématisation des linteaux hauts, confèrent à l’ensemble une grande homogénéité technique, signe d’une construction d’un seul jet répondant à un programme homogène laissé parfois en attente. Dans chaque maison, les jours en archère étroits au rez-de-chaussée, les niches et placards systématiques, le ressaut dans le mur pour porter le plancher d’étage, la distribution de cet étage par une galerie contenant l’accès sur rue, tout accuse la logeabilité quasi urbaine du programme d’ensemble, dont on a réalisé d’abord le mur d’enveloppe, puis les façades sur rue en continu, avant de pratiquer les refends.
Un « barri » se développe en enveloppement sous cette première ceinture fortifiée. Resté probablement ouvert, il semble résulter d’une extension non planifiée, car aucun des symptômes observés dans l’enceinte haute ne s’y vérifie. La mise en place des différentes constructions apparaît au demeurant réduite dans le temps et concentrée sur quelques décennies.
Le site apparaît manifestement antérieur aux principes de défense active de l’architecture royale capétienne, diffusés en Languedoc après la crise albigeoise dans le second tiers du XIIIe siècle. Les caractères « archaïsants » de l’ensemble sont à cet égard marqués par le mur bouclier de tradition impériale germanique et par l’absence de flanquement pour les portes et pour la muraille. À contrario, la présence d’ouvertures de tirs pour l’arc et/ ou l’arbalète ménagées dans le mur bouclier, inconnues en Languedoc avant les années 1200, accuse une datation dans le début du XIIIe siècle. Les observations archéologiques tendent donc à cerner la construction ex nihilo du site, en une seule phase de chantier, dans la première moitié du XIIIe siècle. L’homogénéité des modes constructifs ne fournit pas de datation exacte mais permet de préciser que l’occupation semble avoir été courte, voire que l’ensemble a été abandonné avant achèvement.
La seule certitude concerne la maîtrise d’œuvre du chantier. Non seulement le site semble avoir été globalement réalisé par des équipes homogènes et dans un temps très court, mais la qualité et la technologie de mise en œuvre du chantier sont exceptionnelles pour une construction civile, à l’aune de ce qu’on connaît dans le Languedoc oriental. La qualité des équipes est donc — au même titre que la rapidité d’exécution soulignée par la concomitance des marqueurs typo-stylistiques — le signe d’une maîtrise d’ouvrage puissante disposant de gros moyens sur un temps court.
La première évidence concerne les cellules qui se juxtaposent dans l’enceinte et qui sont sans équivoque des maisons. On retrouve bien à cet égard quelques spécificités des castra languedociens : le perchement, la présence d’un édifice castral, la concentration de l’habitat, la fortification de tout ou partie de l’ensemble. Mais il n’y a ici rien de spontané, contrairement à l’incastellamento languedocien en général, où l’habitat évolue dans un lent processus de développement. Mirabel, en raison précisément de sa faible durée de vie, combine à la fois une opération concertée et une agglomération de type castral ne répondant à aucune typologie connue en Languedoc oriental. Le village répond à un programme unique, à l’image des bastides, mais n’en revêt pas la forme. C’est la principale dissonance qui donne toute sa spécificité à Mirabel : c’est un regroupement planifié qui prend l’allure d’un village castral sans en partager la morphogenèse progressive.
Comment définir dans ces conditions le site de Mirabel, habitat castral à durée de vie limitée, sans structure collective à vocation utilitaire, sans équipement cultuel ? Ce second constat est à nuancer, puisqu’un édifice religieux existe déjà sur la montagne à un kilomètre à l’est : la chapelle Saint-Jean (fin XIIe siècle ?)3. Par ailleurs, il faut sans doute considérer ces maisons comme des espaces polyfonctionnels avec cellier et résidence au moins. Le problème d’interprétation tient au caractère répétitif, quasi modulaire, des maisons juxtaposées, comme s’il s’agissait de casernement préétablis. Cet encellulement n’aurait eu comme seul but que de servir d’habitat-refuge ? La qualité et l’importance du programme suggèrent alors un habitat-refuge à l’échelle d’une vaste seigneurie. La genèse du site répond-elle à une entreprise de regroupement de la population et des activités économiques ayant rapidement avorté, ou à un but sécuritaire temporaire ? Le projet initial avait-il pour but de pérenniser l’habitat ? Le soin apporté à l’exécution contredit au demeurant l’idée que les maisons ne devaient être occupées que temporairement.
Les données historiques peuvent-elles permettre une meilleure connaissance du site ? Les textes disponibles restent peu nombreux et n’apportent presque aucune information directe sur le site. Une nouvelle lecture a cependant été proposée par Jean-Bernard Elzière à la fois à partir des informations lacunaires se rapportant à la localité de Pompignan, mais en y intégrant une approche plus générale, à l’échelle du domaine des seigneurs de Sauve et en s’intéressant plus globalement à l’histoire du Languedoc oriental au début du XIIIe siècle.
Pompignan est d’abord connu comme paroisse, citée dès la seconde moitié du XIe siècle. Le prieuré de Saint-Saturnin dépendait de l’abbaye de Saint-Pierre de Sauve. La documentation du XIIIe siècle relative aux patrimoines des religieux à Pompignan ne fait jamais référence à Mirabel. On peut inférer de cette absence le fait qu’il s’agit des textes spécifiques au prieuré, mais il paraît curieux, qu’un site aussi important n’apparaisse jamais, au moins de manière indirecte. Il est vrai que le contexte primitif de cette paroisse est celui d’un habitat dispersé (manses), le regroupement fortifié de Mirabel n’étant signalé qu’en 1293 dans une liste de castra dépendant de la baronnie de Sauve, à une époque où le site semble déserté6. Tout laisse à penser que la population n’a plus aucun rapport avec Mirabel, au moins à partir du milieu du XIIIe siècle (premiers documents conservés) et que l’impact de la fortification sur le peuplement n’a déjà plus ou n’a simplement jamais eu cours. Sur le plan seigneurial, la plaine de Pompignan, Mirabel y compris, devait toute entière dépendre de la seigneurie de Sauve, tenue par les seigneurs de Sauve, et ce jusqu’en 1243, puis par le roi de France (alors représenté par le sénéchal de Beaucaire et son viguier de Sommières), et enfin après 1293, par l’évêque de Maguelone suite à l’échange de Montpellier et (partie épiscopale de la ville de Montpellier) contre la baronnie de Sauve.
Une famille de Mirabel se repère dans le contexte local à partir du début du XIIIe siècle, dont les membres paraissent avoir migré dans les localités voisines (Anduze et Sauve). Le premier individu identifié est un certain Hugues de Mirabel, chevalier (vers 1180 - après 1226). Il accompagne Pierre Bermond VII, seigneur de Sauve en mai 1226, lors de sa soumission au roi de France, Louis VIII, à Avignon. Cette famille de Mirabel attestée au XIIIe siècle, n’est cependant jamais citée dans le contexte local. Le repli apparent vers des centres de peuplement actifs et centralisateurs (Anduze et Sauve) est peut-être déjà initié au milieu du XIIIe siècle, via les liens qui paraissent unir les Mirabel aux seigneurs de Sauve. Ces mêmes liens peuvent expliquer la carence documentaire concernant le site. Les rapports féodaux-vassaliques en vigueur dans cette région, l’effervescence guerrière qui anime le Languedoc du début du XIIIe siècle (Croisade contre les Albigeois) sont en effet autant d’éléments à prendre en compte.
Parmi les fidèles de Raimond VI, comte de Toulouse, figure Pierre Bermond VI († 1215), seigneur de Sauve, Anduze, etc., époux de Constance. Après 1215, Pierre Bermond VII de Sauve (1203-1254) succède à son père. Il est petit-fils de Raymond VI de Toulouse et neveu de Raymond VII de Toulouse, aux côtés de qui il combattra lors du siège de Beaucaire (1216). Les événements liés à l’histoire de cette famille d’Anduze paraissent déterminants pour situer l’émergence probable du site de Mirabel. Il paraît en effet possible de replacer l’émergence de Mirabel dans le contexte historique de la première moitié du XIIIe siècle et en relation avec le devenir des seigneurs de Sauve. Certains textes relatent, par ailleurs, l’effervescence constructive qui agite les communautés à la veille de la croisade contre les Albigeois, et nous montrent que les événements qui vont avoir lieu à partir de 1209, s’ils n’avaient pas été totalement envisagés dans leur complexité par les méridionaux, n’étaient pas éloignés de leurs préoccupations (anticipation d’une guerre imminente ou d’une reprise de vieux conflits). Il n’est donc pas improbable que le projet d’un village fortifié ait germé dès les premières années du XIIIe siècle. Une date possible est peut-être à rechercher autour de 1216-1219, période qui voit à la fois un retournement de situation favorable au camp toulousain et une bonne situation financière pour les seigneurs de Sauve.
L’entreprise de l’agglomération de Mirabel semble s’inscrire à la fois dans un mouvement tardif de « perchement » (cadre général du peuplement en Languedoc) et dans une optique défensive générée par le contexte politique. L’objectif semble avoir largement dépassé le cadre d’une simple forteresse ou habitat refuge, mais quel que fut ce but, il n’a plus cours dès lors que le contexte qui a présidé à son émergence est achevé. En effet, Mirabel recèle matériellement les signes d’une interruption d’un processus d’encellulement planifié. Cet arrêt peut facilement être mis en relation avec la mise au pas de Pierre Bermond VII en 1243.
La punition pour « forfaiture » est clairement explicitée par l’interdiction de construire de nouvelles fortifications (cf. le site de Paulhan en aval d’Anduze, barrant le Gardon face à Tornac, qui présente un mur-bouclier à archères identique), ce qui sous-tend qu’au cours des années où le seigneur de Sauve avait suivi le camp toulousain et manifesté sa propre opposition au pouvoir royal, celui-ci ne s’était pas gêné pour fortifier ses possessions. Si l’on prend en compte un premier chantier initié vers 1205-1209 ou vers 1216-1219, ainsi qu’une période de construction entrecoupée de quelques phases d’inactivités (problèmes liés aux guerres et aux financements), un étalement sur une vingtaine d’années parait suffisant pour ériger l’ensemble des structures visibles.
On peut donc parfaitement considérer le seuil des années 1240 comme un terminus ante quem probable. Or une fois ce projet plus ou moins achevé, l’éviction brutale et définitive de ses initiateurs, rend caduque son utilité. Les observations de terrain tendent également à prouver un usage resserré dans le temps ou aucun usage prolongé. Il ne faut pas pour autant inférer de cette absence d’exploitation, une raison d’être ponctuelle (notion d’habitat refuge). Les agglomérations proprement castrales du secteur sont plutôt rares (Durfort est à plus de 13 km au nord-est), l’habitat y est naturellement dispersé. Le cas du castrum voisin de Montoulieu (à un peu plus de 8 km au nord-ouest), montre que la greffe du modèle du castrum de plaine prend difficilement dans ce territoire de piedmont cévenol9. Mirabel s’inscrit dans un mouvement tardif et coercitif de « perchement » de la population qui s’avère être un échec.
Par Vivien Vassal et Nicolas Faucherre