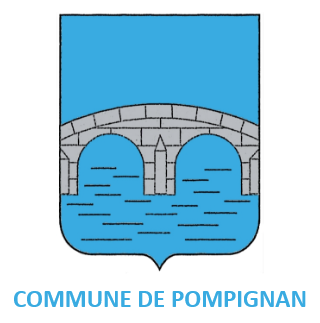Vous êtes ici : Accueil > Culture / Loisirs > Tourisme > Des Cromlechs au Chateau de Mirabel
Des cromlechs au château de Mirabel
Dans la vallée de Pompignan, dominée par la montagne Saint-Jean, l’histoire des hommes s’inscrit depuis des millénaires dans les pierres et les reliefs. Bien avant le Moyen Âge, la plaine accueillait deux cromlechs d’une ampleur rare pour le Midi : leurs cercles de pierres mesuraient respectivement 95 et 98 mètres de diamètre, quand la plupart des enceintes connues dans la région n’en atteignent que dix à trente. Leur monumentalité témoigne de rites collectifs d’une intensité exceptionnelle et d’une organisation sociale capable de mobiliser une communauté entière. Ces cercles, aujourd’hui à demi effacés, rappellent que la vallée fut dès la protohistoire un espace sacralisé, marqué par un culte solaire ou cosmique dont la trace demeure inscrite dans le paysage.
Deux millénaires plus tard, les pentes et sommets alentour furent occupés par des oppida, dont celui de Ceyrac, confirmant l’importance stratégique de ce passage. Car la vallée de Pompignan n’était pas un cul-de-sac : elle ouvrait au sud sur la plaine méditerranéenne et, au nord, elle constituait le couloir le plus aisé pour franchir le Vidourle à Conqueyrac et gagner les Cévennes. Véritable carrefour entre deux mondes, elle fut convoitée de tout temps et les reliefs qui la dominent servirent tour à tour de sanctuaire, de refuge et de vigie.
Sur le sommet de la montagne Saint-Jean s’éleva au XIIIᵉ siècle le castrum de Mirabel, cité dès 1237. Perché à 285 mètres d’altitude, il se divisait en deux ensembles : une haute-cour seigneuriale soigneusement bâtie à la chaux, dotée d’une grande salle, d’une tour et d’une citerne voûtée, et en contrebas un village de maisons en pierre sèche étagées le long de ruelles étroites. Un large fossé et un puissant mur bouclier protégeaient l’accès depuis le plateau. L’implantation tirait profit de la falaise naturelle et traduisait le rôle stratégique du site, tenu par la famille de Mirabel, alliée aux puissants Bermond d’Anduze et aux Sauve. La tour de guet, dressée sur ce belvédère, contrôlait l’axe de circulation reliant la Méditerranée aux Cévennes par le passage de Conqueyrac. Elle prenait sans doute la suite de dispositifs plus anciens de veille et de signal, et formait un relais au sein d’un véritable réseau de tours fortifiées jalonnant le piémont, du castellas de Saint-Hippolyte à celui de Montoulieu, de Durfort aux Jumelles, de Fressac à Vibrac ou Tornac.
À l’extrémité orientale du plateau, une chapelle dédiée à Saint-Jean, édifiée à l’époque romane – ce qui laisse entendre qu’elle a pu exister avant le fort – venait donner au site une dimension religieuse. Son abside en cul-de-four et son appareil régulier témoignent d’une construction sobre et soignée. Autour, des annexes et un enclos en pierre sèche rappellent que ce lieu, distinct du castrum, remplissait une fonction liturgique et communautaire.
Avec le temps, la forteresse de crête perdit de son attrait. Dès le XVe siècle, l’habitat se replia vers la plaine, autour de l’église paroissiale Saint-Saturnin, aujourd’hui disparue mais attestée dans les textes. Celle-ci devait se situer dans le voisinage de l’actuel village, et non à l’écart du côté du château, soit au pied de la montagne. Le toponyme même de Pompignan rappelle une origine plus ancienne encore : Pompinianum, « le domaine de Pomponius », un notable gallo-romain dont la propriété donna son nom au terroir.
Les seigneurs, quittant leur nid d’aigle médiéval, construisirent alors au XVe siècle un nouveau château, au pied du mont de Mirabel, à l’emplacement d’un ancien manoir fortifié attesté dès 1475. Ce château, que l’on désigna de Mirabel pour le distinguer du village perché, surnommé Mirabel-le-Vieux, devint le centre seigneurial d’un bourg en plein essor. Le développement du village de Pompignan, avec ses maisons à meneaux des XVe et XVIe siècles, traduit cette prospérité nouvelle.
Ainsi, du cercle monumental des cromlechs aux ruines du castrum médiéval, de la chapelle romane aux demeures de la Renaissance, la vallée de Pompignan offre une continuité remarquable. Chaque époque y a projeté ses croyances, ses stratégies ou son autorité, sans jamais rompre avec l’importance originelle de ce passage. Entre Cévennes et Méditerranée, au croisement des voies de circulation et des mémoires, ce paysage habité raconte l’histoire longue d’un territoire toujours convoité et toujours réinvesti.
Mirabel-le-Vieux correspond à une propriété privée.
- Paul Louis Cazalis de Fondouce, Bulletin de la Société préhistorique de France – 1904.
- Vivien Vassal & Nicolas Faucherre, Le Lien des Chercheurs Cévenols – Octobre-Décembre 2014 (N° 179).
- Thierry Ribaldone, La chapelle Saint-Jean à Pompignan, Cahiers du Haut Vidourle N° 25 – mars 2017.